Depuis ses débuts, le capitalisme est un système marqué par les crises. Comme l’a observé Trotsky, il traverse des cycles d’expansion et de récession avec autant de naturel que le corps humain inspire et expire. Mais quelle est la véritable nature de la crise du capitalisme ? Cette question a longtemps fait l’objet de débats dans les cercles marxistes et a souvent donné lieu à des disputes et à des divisions entre factions. Cependant, la question n’est pas un mystère insoluble.
Marx et Engels ont été les premiers à réfuter scientifiquement la « loi de Say » de l’économie classique — qui affirmait que la production de biens génère automatiquement sa propre demande — et à démontrer le caractère inévitable de la surproduction dans le capitalisme. Cette tendance découle de la contradiction fondamentale entre la production sociale et l’appropriation privée, ou, en d´autres termes, entre les forces productives et les rapports de production. Une analyse plus approfondie révèle qu’elle est enracinée dans la nature contradictoire de la marchandise elle-même.
Marx a sévèrement critiqué les économistes bourgeois qui niaient la possibilité d’une surproduction en arguant que tout vendeur doit nécessairement avoir un acheteur. Comme l’a souligné Marx, le fait que « toute vente implique un achat » est une tautologie, une simple définition de l’échange. Certes, « personne ne peut vendre à moins qu’un autre n’achète. Mais personne n’est immédiatement obligé d’acheter simplement parce qu’il a vendu ». L’argent provenant d’une vente peut être accumulé plutôt que dépensé, ce qui rend possible la surproduction et la crise.
Mais Marx est allé plus loin. Il a expliqué que le réinvestissement des capitalistes dans de nouvelles usines, de nouvelles machines ou de la main-d’œuvre dépend entièrement de la rentabilité.
Si le problème était aussi simple que la surproduction, Marx et Engels n’auraient pas passé leur vie à analyser le capitalisme dans des milliers de pages. Après tout, ils avaient déjà identifié la tendance du capitalisme à la surproduction dans Le Manifeste communiste. Marx a toutefois continué à travailler sur Le Capital jusqu’à ses derniers jours. Les volumes II et III ont été publiés par Engels après la mort de Marx, tandis que Théories de la plus-value, considéré comme le volume IV, a été publié sous forme incomplète après le décès d’Engels.
La tendance à la surproduction est inhérente au capitalisme. Cependant, elle ne représente qu’un aspect de sa crise plus profonde et prolongée. Réduire le problème à une simple « crise de surproduction » est une simplification excessive. Non seulement cela offre une vision partielle, mais cela n’explique pas non plus de nombreux phénomènes politiques et économiques. En fin de compte, cette interprétation conduit au réformisme keynésien, c’est-à-dire à injecter de l’argent dans l’économie pour stimuler la demande et ainsi vendre les biens et services surproduits.
À cet égard, le troisième volume du Capital est crucial. Son thème central est la force motrice du capitalisme — le profit — et la mesure décisive qui sous-tend d’innombrables indicateurs économiques : le taux de profit. En bref, l’analyse par Marx de la réalisation des profits dans toutes ses dimensions l’a conduit à formuler une théorie globale des crises : la « loi de la tendance à la baisse du taux de profit ». Les économistes classiques avaient déjà observé que la rentabilité tendait à diminuer à long terme, mais ils ne disposaient pas des moyens de la comprendre pleinement.
Marx a démontré que la rentabilité de la production capitaliste n’est pas stable. Elle est soumise à une pression à la baisse inévitable. La dynamique de la concurrence sur le marché oblige finalement les capitalistes à surinvestir (ou à suraccumuler) par rapport aux profits qu’ils peuvent tirer de la classe ouvrière. À un certain point, la suraccumulation par rapport aux profits — c’est-à-dire un taux de profit décroissant — empêche la masse totale des profits de continuer à croître. Lorsque cela se produit, les capitalistes cessent d’investir et de produire, ce qui conduit à une surproduction ou à une crise capitaliste. Cependant, un taux de profit décroissant ne déclenche pas à lui seul une crise tant que la masse des profits continue de croître.
Bien sûr, il est indéniable qu’une production excessive peut se produire dans des secteurs spécifiques, créant des crises partielles à partir d’une production disproportionnée. Celles-ci peuvent parfois provoquer de graves perturbations systémiques. Cependant, en ce qui concerne la crise générale et historique du capitalisme, la limite décisive à la production est le profit du capitaliste. L’accumulation n’est donc pas directement déterminée par le taux de plus-value, mais par le rapport entre celui-ci et la dépense totale de capital — c’est-à-dire le taux de profit — et, de manière encore plus décisive, par la masse totale des profits. Un taux de profit en baisse reflète essentiellement une surproduction de capital fixe.
Il est vrai que le taux de profit peut diminuer tandis que la masse du profit continue d’augmenter. En fait, le taux de profit peut baisser si progressivement que l’économie continue de croître pendant des années malgré cette tendance Cependant, ces conditions ne peuvent pas durer indéfiniment. .
Le point essentiel peut se résumer ainsi : sous le capitalisme, il existe une tendance inhérente à la proportion de capital constant (machines, ordinateurs, robots, outils et, aujourd’hui, intelligence artificielle) à croître par rapport au capital variable, c’est-à-dire la main-d’œuvre humaine, dans le processus de production. Cela engendre ce que Marx a appelé une « surproduction de capital », plus précisément une « suraccumulation », ou ce qu’il a également décrit comme une « abondance de capital ». Au-delà d’un certain point, les capitalistes ne peuvent plus employer ce capital accumulé de manière rentable. En d’autres termes, la plus-value produite devient insuffisante par rapport à l’investissement total et le taux de profit diminue. Au cours de ces périodes, le taux de profit peut diminuer tandis que les profits totaux continuent d’augmenter. Cependant, avec le temps, la masse des profits commence à diminuer. À ce stade, la crise éclate : les investissements s’arrêtent, la production s’effondre, l’économie se contracte, les emplois disparaissent et les salaires sont réduits. Cela réduit la « demande effective » sur le marché. Les stocks débordent, les biens et la capacité de production existent, mais les acheteurs font défaut, d’où la surproduction.
Inévitablement, ce processus se manifeste dans le secteur financier, l’immobilier et le marché boursier, où éclatent des bulles spéculatives qui se sont gonflées pendant de longues périodes. Nous avons vu cette dynamique se dérouler lors de la crise financière de 2008.
Ainsi, la surproduction de biens est indissociable de la surproduction de capital. Comme l’a dit Marx : « La surproduction de capital implique toujours la surproduction de biens… ».
Comment le capitalisme émerge-t-il de ces crises ? Paradoxalement, les conditions mêmes de la crise créent la possibilité d’une reprise. Les faillites éliminent ou dévalorisent de grandes quantités de capital « excédentaire » dans un processus appelé « destruction créatrice ». Les prix des moyens de production (capital constant) baissent. Le chômage réduit les salaires. De cette manière, l’investissement redevient rentable et le cycle d’accumulation reprend.
Les grandes guerres peuvent également ouvrir la voie à la « reprise », bien que de manière beaucoup plus destructrice et sanglante, par le biais des mêmes mécanismes.
Même dans des conditions relativement pacifiques, il existe des forces compensatoires qui contrebalancent temporairement la tendance à la baisse du taux de profit. Il s’agit notamment de l’intensification de l’exploitation des travailleurs par la répression syndicale, les licenciements et la baisse des salaires. L’innovation technologique réduit le coût du capital constant, ce qui contribue à maintenir la rentabilité. En outre, les États capitalistes sont contraints d’adopter des politiques qui stimulent les marges bénéficiaires, contrebalançant ainsi artificiellement la tendance à la baisse du taux de profit. La privatisation transforme les services publics en espaces de profit, tandis que de nouvelles industries émergent grâce aux progrès technologiques. La destruction de l’environnement, l’expansion impérialiste et la conquête de marchés, de ressources et de main-d’œuvre à bas prix contribuent également à cet objectif. La déréglementation et les exonérations fiscales accordées aux capitalistes se font au détriment des travailleurs, souvent par le biais de mesures d’austérité, en transférant la charge fiscale vers le bas, en réduisant considérablement les programmes de protection sociale ou en les vendant au capital privé.
Le néolibéralisme a essentiellement été un projet à grande échelle visant à renforcer ces tendances contraires, afin de rétablir la rentabilité.
Cependant, à long terme, la tendance à la baisse du taux de profit se confirme. La marge de récupération se réduit et les crises s’aggravent. L’histoire a confirmé la prédiction du Manifeste communiste, plusieurs décennies avant la rédaction du Capital.
À la lumière de ce qui précède, il n’est pas difficile de voir que les principaux problèmes socio-économiques du capitalisme découlent de la crise de rentabilité. Une faible rentabilité se traduit inévitablement par un faible investissement, une croissance lente, une faible création d’emplois et une détérioration du niveau de vie. Elle affaiblit également la capacité de l’État à taxer la classe capitaliste, ce qui entraîne une baisse des recettes, une augmentation du déficit, une augmentation de la dette et des mesures d’austérité. En fait, tous ces processus sont dialectiquement liés, se renforçant mutuellement et aggravant ainsi la crise générale.
Nous verrons ci-après comment le capitalisme contemporain, en particulier dans ses formes avancées, est pris au piège dans des processus découlant de sa crise organique.
Croissance : de l’essor à la stagnation
La Seconde Guerre mondiale a donné un nouvel élan au capitalisme grâce à de vastes économies de guerre et à une destruction sans précédent, mais les contradictions fondamentales du système ont persisté. L’analyse des taux de croissance de l’après-guerre le montre clairement.
Il existe un vaste débat parmi les économistes marxistes concernant les données empiriques relatives à la TDTG (?). Nous considérons que les chiffres présentés sur le blog de Michal Roberts sont particulièrement utiles, notamment ceux basés sur la base de données de Basu Wasner, qui résument les tendances et les points d’inflexion de l’évolution du taux de profit déflaté des économies du G20, constituant une base essentielle pour la périodisation de l’après-guerre et l’analyse des perspectives économiques actuelles.
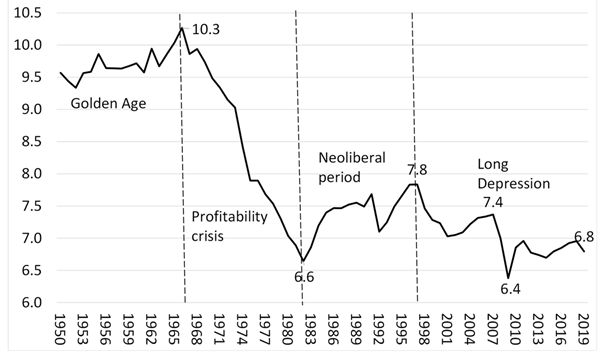
Il est assez évident que la courbe présente des fluctuations : (1) une croissance exceptionnelle du taux de profit dans l’immédiat après-guerre jusqu’au milieu des années 1960 ; (2) une forte baisse jusqu’au début des années 1980 ; (3) le rétablissement d’une tendance à la hausse du taux de profit dans les années 1980 et 1990 ; (4) une nouvelle baisse depuis le début des années 2000, bien qu’à un niveau beaucoup plus bas, donc moins prononcée qu’autour de 1970.
L’après-guerre a été rendu possible par les terribles défaites du mouvement ouvrier (le fascisme, la solution réactionnaire de la période révolutionnaire d’après-guerre, l’intégration des syndicats, la social-démocratie et le stalinisme dans l’ordre capitaliste d’après-guerre), la destruction massive du capital (non seulement physique due à la guerre, mais aussi due aux effets de la crise économique qui y était associée jusqu’à la fin des années 1940) et la résolution décisive du conflit entre les puissances impérialistes pour le partage du monde, les États-Unis devenant la puissance hégémonique mondiale et le garant du marché mondial, et le dollar assumant le rôle de monnaie mondiale.
Si le taux de profit a commencé à baisser dès les années 1960, ce qui se reflétait déjà dans les turbulences des marchés financiers, les limites à la croissance de la masse absolue des profits se sont fait sentir dans les principaux pays impérialistes, d’abord dans les tendances récessives du début des années 1970. Il était évident que le « long boom » avait pris fin, et avec lui, les illusions de « coopération sociale » et d’État-providence croissant. La plupart des gouvernements de l’époque ont tenté de contrer les cycles de récession par une augmentation des dépenses publiques, financée par l’augmentation de la dette publique. Cette période a été marquée par une crise structurelle de rentabilité, comme en témoignent la crise des prix du pétrole et l’effondrement du système de Bretton Woods.
Vers 1980, le noyau de la bourgeoisie impérialiste occidentale, en particulier aux États-Unis et en Grande-Bretagne, a décidé d’opérer un changement fondamental dans sa gestion de la crise, qui sera par la suite connu sous le nom de « tournant néolibéral ». Cela a non seulement entraîné des attaques massives contre les acquis et les organisations de la classe ouvrière, comme celles des gouvernements Reagan et Thatcher, mais aussi le début de cycles interminables de politiques d’austérité. Au cœur de ce changement se trouvait le « choc Volcker », symbole de l’augmentation massive du taux préférentiel des prêts et de la crise de la dette qui s’ensuivit.
Deux récessions ont immédiatement suivi dans les années 1980, augmentant le taux de chômage, mais mettant également fin à l’ère de l’inflation. Le défaut de paiement des dettes des entreprises qui s’ensuivit, l’effondrement des caisses d’épargne, l’insolvabilité des grandes sociétés, etc., entraînèrent une destruction de capital de plusieurs milliards de dollars (on estime qu’environ un cinquième du capital social était inopérant au début des années 1980). En outre, la plupart des pays fortement endettés en dollars (en raison des taux d’intérêt plus élevés et de la force du dollar) ont nécessairement connu une grave crise de la dette.
Le nouveau modèle de croissance lancé par le tournant néolibéral du début des années 1980 a été appelé « période de mondialisation ». L’effet de levier de la restructuration de la dette, le tournant néolibéral mondial et la rupture du bloc des États ouvriers dégénérés ont permis une plus grande ouverture des marchés au capital d’investissement mondial. Cela a favorisé la construction de chaînes de production mondiales de plus en plus sophistiquées, basées sur un accès favorable aux matières premières et à une main-d’œuvre bon marché et qualifiée à l’échelle mondiale. Une autre caractéristique de l’essor de la mondialisation a été la nouvelle dimension prise par la finance, en particulier les marchés mondiaux des capitaux. Grâce à la libéralisation des flux financiers internationaux et des réglementations en matière d’investissement, l’accumulation de capital financier à l’échelle mondiale et son investissement global ont permis de mobiliser des capitaux d’investissement à une échelle sans précédent. La reprise du capital en Europe de l’Est, en Union soviétique et en Chine à partir de 1990 a sans aucun doute été un facteur important dans le nouveau modèle de croissance.
L’essor de la mondialisation s’est heurté aux limites fondamentales de l’accumulation de capital. Même à un niveau mondial plus élevé, la masse croissante de capital s’est heurtée à une plus-value limitée, ce qui a entraîné une nouvelle baisse des taux de profit au début du siècle. L’augmentation des coûts de transport et de logistique, l’expansion des secteurs des services et le poids croissant des attentes du marché financier ont renforcé cette tendance. Les premières crises en Russie et en Asie, ainsi que l’effondrement des entreprises « dot-com », ont révélé des problèmes dans le moteur de la mondialisation.
Si l’essor chinois et l’expansion financière ont prolongé la croissance, la baisse de la rentabilité a rendu une crise inévitable, qui a cette fois éclaté dans le secteur financier. La chute des prix de l’immobilier a déclenché un effondrement massif de la dette et de la valeur des actifs. L’effondrement des institutions financières en 2007 a provoqué une crise du crédit et une chute du financement des investissements, qui a abouti à la profonde récession mondiale de 2008-2009, appelée par la suite la « Grande Récession ». Ce quasi-effondrement du capitalisme a marqué la période jusqu’à la prochaine grande crise : la récession mondiale provoquée par la pandémie.
Le bilan du Japon est encore plus décevant : après avoir connu une croissance annuelle de 8 à 10 % jusqu’en 1973, son économie a à peine réussi à rester au-dessus de zéro depuis 2008.
Le ralentissement est encore plus flagrant si l’on compare les 15 années qui ont précédé et suivi la crise de 2008. Les taux de croissance annuels moyens des principales économies ont diminué de la manière suivante (1993-2007 vs 2009-2023) :
• Allemagne : 1,4 % → 0,9 %
• France : 2,0 % → 0,9 %
• Royaume-Uni : 2,7 % → 1,2 %
• Zone euro dans son ensemble : 2,0 % → 0,9
• Japon : 1,0 % → 0,4 %
• États-Unis : 3,0 % → 2,0 %
• Monde arabe : 4,4 % → 2,5 %
Selon la Banque mondiale, la croissance du PIB mondial devrait atteindre en moyenne seulement 2,5 % dans les années 2020, soit le rythme le plus lent depuis les années 1960. De même, l’OCDE prévient que l’économie mondiale entre dans sa période de croissance la plus faible depuis la crise du COVID-19 : « L’affaiblissement des perspectives économiques se fera sentir dans le monde entier, pratiquement sans exception ».
L’OCDE prévoit un fort ralentissement de la croissance aux États-Unis, qui passerait de 2,8 % en 2024 à 1,6 % en 2025 et à 1,5 % en 2026, tandis que l’inflation avoisine les 4 %, restant supérieure à l’objectif de la Réserve fédérale et empêchant toute baisse des taux d’intérêt qui permettrait d’alléger le fardeau de la dette des ménages et des petites entreprises.
La Banque mondiale souligne que ce ralentissement n’est pas un phénomène récent. La croissance des économies en développement a diminué pendant trois décennies consécutives : de 5,9 % dans les années 2000 à 5,1 % dans les années 2010 et à 3,7 % depuis le début des années 2020. Cela reflète la tendance à la baisse de la croissance du commerce mondial (5,1 % → 4,6 % → 2,6 %). Les investissements ont également faibli, tandis que la dette s’est accumulée.
Dans sa mise à jour de juillet, le FMI a légèrement relevé ses prévisions de croissance mondiale à 3,0 % en 2025 et 3,1 % en 2026, invoquant l’atténuation prévue des droits de douane, l’expansion budgétaire et l’amélioration des conditions financières. Il met toutefois en garde contre des risques persistants : augmentation des droits de douane, tensions géopolitiques et incertitude constante.
Les prévisions pour 2025-2026 sont les suivantes :
• États-Unis : 1,9 % (2025), 2,0 % (2026)
• Zone euro : 1,0 %, 1,2 %
• Royaume-Uni : 1,2 %, 1,4 %
• Chine : 4,8 %, 4,2 %
• Japon : 0,7 %, 0,5 %
À la mi-2025, le PIB de l’Allemagne et de l›Italie a reculé de -0,1 % au deuxième trimestre, tandis que celui de la France n´a progressé que de 0,3 %. La croissance globale de la zone euro n’a été que de 0,1 % en glissement trimestriel, avec un ralentissement en glissement annuel de 1,5 % au premier trimestre à 1,4 %. Les principales économies de la zone euro sont en stagnation ou en récession, et seules certaines économies périphériques, comme l’Espagne, affichent des performances relativement meilleures.
Dans le même temps, les données des États-Unis pour le deuxième trimestre 2025 ont montré une augmentation trimestrielle de 0,7 % (annualisée à 3,0 %), supérieure aux prévisions. Trump s’est félicité de ce résultat, mais cette augmentation est en grande partie due à une forte baisse de 30 % des importations suite à l’entrée en vigueur des hausses tarifaires. Cela a stimulé le commerce net, gonflant le PIB. Si l’on exclut les effets commerciaux, les ventes finales réelles aux acheteurs privés nationaux n’ont augmenté que de 1,2 %, contre 1,9 % au premier trimestre.
Les investissements ont également connu un ralentissement spectaculaire : les investissements totaux n’ont augmenté que de 0,4 % au deuxième trimestre, contre 7,6 % au premier trimestre. Les investissements en équipements ont augmenté de 4,8 % contre 23,7 % précédemment, tandis que les investissements dans de nouvelles structures (usines, centres de données, bureaux) ont chuté de 10,3 % après avoir déjà diminué de 2,4 % au premier trimestre. Dans l’ensemble, l’économie américaine a connu une croissance de 2,0 % en glissement annuel au deuxième trimestre, soit le même rythme qu’au premier trimestre. Bien qu’elle continue d’afficher de meilleurs résultats que la zone euro et le Japon, son rythme d’expansion est inférieur de moitié à celui de la Chine.
L’économie japonaise est en proie à une stagnation chronique. Elle s’est contractée au premier trimestre 2025, et les chiffres du commerce laissent présager une nouvelle contraction au deuxième trimestre, ce qui implique une récession technique. Dans le meilleur des cas, le Japon ne connaîtra qu’une croissance de 0,7 % cette année et de 0,4 % l’année prochaine.
L’OCDE souligne qu’une longue période de faibles investissements a aggravé les défis à long terme auxquels sont confrontées les économies de l’OCDE, ce qui affaiblit encore davantage les perspectives de croissance. Malgré la hausse des bénéfices, de nombreuses entreprises ont préféré accumuler des actifs financiers et reverser des fonds aux actionnaires plutôt que d’investir dans des immobilisations.
La Banque mondiale ajoute : « Les pays les plus pauvres seront les plus touchés. D’ici 2027, le PIB par habitant des économies à revenu élevé reviendra approximativement à son niveau d’avant la COVID-19. Cependant, les économies en développement resteront 6 % en dessous. À l’exception de la Chine, la plupart d’entre elles mettront deux décennies à récupérer les pertes subies dans les années 2020 ». En d’autres termes, les nations les plus pauvres du monde ne comblent pas leur retard, mais le creusent encore davantage. Même selon les indicateurs déjà modestes de la Banque mondiale, la pauvreté augmente.
Austérité : une nouvelle normalité
L’austérité, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est apparue avec la montée en puissance du néolibéralisme dans les années 1980. Cependant, elle a pris au fil du temps un caractère plus persistant et plus sévère. Elle implique désormais non seulement les mesures d’austérité internes imposées par les États capitalistes, mais aussi la fin virtuelle des concessions et des subventions accordées par le Nord global aux régions les plus pauvres du monde, déjà dévastées par des siècles de pillage et d’exploitation par l’impérialisme.
Aux États-Unis, par exemple, le président Trump a considérablement réduit le financement et les effectifs de l’agence américaine de développement, l’USAID. Son budget devrait passer de 60 milliards de dollars en 2024 à moins de 30 milliards de dollars en 2026. Des coupes similaires sont en cours en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et dans d’autres économies avancées, les gouvernements réorientant les fonds vers des augmentations massives des dépenses militaires.
Le Groupe des Sept (G7), qui représente près des trois quarts de l’aide publique au développement (APD), s’apprête à réduire ses dépenses d’aide de 28 % entre 2024 et 2026. Il s’agira de la plus forte réduction de l’aide de puis la création du G7 en 1975 et, en fait, depuis le début de l’aide en 1960. D’ici 2026, le niveau de l’aide du G7 pourrait chuter de 44 milliards de dollars, pour atteindre seulement 112 milliards. La majeure partie de cette diminution provient des États-Unis (33 milliards de dollars en moins), de l’Allemagne (3,5 milliards de dollars en moins), du Royaume-Uni (5 milliards de dollars en moins) et de la France (3 milliards de dollars en moins).
Les organismes internationaux ont tiré la sonnette d’alarme. Oxfam avertit que ces coupes représentent la plus forte réduction de l’aide au développement depuis 1960. Parallèlement, l’ONU souligne un écart considérable de 4 000 milliards de dollars entre les besoins mondiaux en matière de développement durable et le financement réel. L’impact sur la nutrition est à lui seul dévastateur : l’aide mondiale consacrée à la nutrition devrait diminuer de 44 % d’ici 2025 par rapport à 2022. L’annulation de 128 millions de dollars de programmes de nutrition infantile financés par les États-Unis, qui couvraient un million d’enfants, entraînera 163 500 décès supplémentaires d’enfants par an.
Les systèmes de santé des pays les plus pauvres sont également sous pression. Un dollar sur cinq de l’aide allouée aux budgets de la santé est en cours de réduction ou risque de l’être. Selon l’OMS, près des trois quarts de ses bureaux nationaux signalent de graves perturbations dans leur fonctionnement, et dans environ un quart de ces pays, ils ont déjà dû fermer complètement leurs centres de santé. Les réductions de l’aide américaine pourraient entraîner jusqu’à 3 millions de décès évitables par an, 95 millions de personnes perdant leur accès aux soins médicaux : des enfants mourant de maladies évitables par la vaccination, des femmes enceintes privées de soins maternels et une augmentation des décès dus au paludisme, à la tuberculose et au VIH.
Au niveau national, le projet de loi budgétaire de Trump propose une austérité encore plus grande. Au cours de la prochaine décennie, il prévoit de réduire de près d’un billion de dollars le budget de Medicaid (le programme de santé publique pour les ménages à faibles revenus) et de 500 milliards de dollars celui de l’aide alimentaire et de Medicare (couverture médicale pour les personnes âgées). Il s’agit de la plus forte réduction jamais subie par le réseau de sécurité sociale américain, déjà fragile. Les conséquences sont graves. Entre 12 et 17 millions de personnes pourraient perdre leur assurance maladie, tandis que 3 millions risquent de perdre leur aide alimentaire. Les hôpitaux du filet de sécurité, en particulier dans les zones rurales, réduiront leurs services ou fermeront complètement. Les réductions des subventions prévues par la loi sur les soins de santé abordables augmenteront les dépenses à la charge des assurés, répartissant l’impact entre tous les régimes d’assurance maladie. Dans le même temps, le projet de loi rend permanentes les réductions d’impôts de 2017, qui profitent de manière prépondérante aux plus riches. Selon les estimations, si l’on tient compte à la fois des réductions d’impôts et des réductions des programmes, 20 % des ménages les plus pauvres verront leurs revenus diminuer, tandis que les 0,01 % les plus riches bénéficieront d’un gain moyen de 301 550 dollars par an.
L’Europe connaît une situation similaire. Les politiques d’austérité mises en œuvre dans toute l’UE depuis 2009 ont privé les citoyens, en moyenne, de 3 000 euros par an, selon une étude de la New Economics Foundation (NEF) et de Finance Watch. Les dépenses publiques et sociales sont inférieures de 1 000 euros par personne à ce qu’elles auraient été sans l’austérité. Les conséquences sont particulièrement graves dans des pays comme l’Irlande et l’Espagne, où les revenus moyens ont chuté de 29 % et 25 % par rapport aux tendances antérieures à 2008. Même dans des États plus riches comme la Finlande et les Pays-Bas, les revenus restent inférieurs de 15 % à 16 % aux prévisions.
Le rapport souligne le coût plus large : sans l’austérité, le citoyen moyen de l’UE disposerait aujourd’hui de 2 891 euros de plus. Les gouvernements auraient investi 533 milliards d’euros supplémentaires dans les infrastructures, notamment dans les énergies renouvelables et les capacités d’approvisionnement domestique, protégeant ainsi les familles contre les hausses actuelles des prix de l’énergie. Les dépenses en matière d’éducation, de santé et d’aide sociale seraient également supérieures de 1 000 euros par personne. En réalité, l’austérité a aggravé les récessions au lieu de les atténuer. Elle a affaibli les réseaux de sécurité sociale, érodé le niveau de vie, ralenti la reprise et, surtout, infligé des dommages disproportionnés aux plus vulnérables : les pauvres, les jeunes, les familles et les populations dépendantes des soins médicaux.
La dette : le poids étouffant du temps emprunté
L’économie mondiale est écrasée par un énorme fardeau de la dette, ce qui reflète la manière dont les mesures temporaires visant à atténuer les crises et les méthodes artificielles pour remédier aux goulets d’étranglement du système sont devenues permanentes et se sont normalisées. La dette mondiale approche les 300 % du PIB mondial, un niveau dangereusement élevé. Au cours des quelques années qui ont suivi la COVID-19, la dette a augmenté de 43 %, une tendance insoutenable.
En outre, la hausse des taux d’intérêt après la COVID-19 a aggravé la crise de la dette dans la plupart des pays du tiers monde. Le Pakistan souffre de cette situation depuis des années, et le cas du Sri Lanka est bien connu. Selon les Nations unies, 52 pays en développement sont confrontés à une crise de la dette, dont 40 % risquent de se retrouver en défaut de paiement. Ces pays dépensent davantage pour le paiement des intérêts que pour la santé ou l’éducation.
Si les guerres commerciales mondiales s’intensifient, l’inflation et les taux d’intérêt augmenteront, ce qui pourrait provoquer des crises similaires à celles du Sri Lanka ou du Bangladesh dans de nombreux autres pays.
Dans les économies dites émergentes (à l’exception de la Chine), la dette totale a atteint 126 % du PIB. Le solde de la dette extérieure des pays les plus pauvres a atteint le chiffre sans précédent de 8 800 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à l’année précédente.
Il est particulièrement alarmant de constater que les remboursements de la dette dépassent désormais les nouvelles entrées de crédit et de capitaux. En 2023, les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire (à l´exception de la Chine) ont subi une sortie nette de 30 milliards de dollars vers le secteur privé au titre de la dette à long terme, ce qui représente un lourd fardeau pour le développement. Depuis 2022, les créanciers privés étrangers ont retiré 141 milliards de dollars de plus en paiements au titre du service de la dette des emprunteurs du secteur public dans les économies en développement qu’ils n’ont déboursé en nouveaux financements. Pendant deux années consécutives, les créanciers extérieurs ont obtenu plus qu’ils n’ont apporté.
Le coût total du service de la dette (capital plus intérêts) de tous les pays à faible et moyen revenu a atteint le chiffre record de 1 400 milliards de dollars en 2023. Si l’on exclut la Chine, ce chiffre s’élève à 971 milliards de dollars, soit une augmentation de 19,7 % par rapport à l’année précédente et plus du double du niveau d’il y a dix ans.
L’impact social est dévastateur : 3,3 milliards de personnes vivent dans des pays où les paiements d’intérêts dépassent les dépenses de santé, tandis que 2,7 milliards vivent dans des pays où le coût du service de la dette dépasse les budgets de l’éducation. En moyenne, la charge des intérêts en pourcentage des recettes fiscales a presque doublé depuis 2011 dans les pays en développement.
Même les économies avancées s’endettent de plus en plus. Aux États-Unis, le Comité pour un budget fédéral responsable prévoit que la dette publique augmentera d’au moins 3 300 milliards de dollars d’ici 2034, ce qui portera le ratio dette/PIB de 100 % actuellement à 125 %, bien au-dessus des 117 % prévus par la législation en vigueur. Les déficits annuels devraient également augmenter, atteignant 6,9 % du PIB d’ici 2034, contre 6,4 % en 2024.
Le secteur privé n’est pas moins surchargé. Les entreprises américaines supportent actuellement la plus lourde dette de leur histoire, avec un encours de dette atteignant 487 % de leurs revenus. Au cours des deux dernières années, les faillites d’entreprises ont augmenté de 87 %, dépassant les niveaux observés pendant la crise de la COVID-19, un résultat aggravé par les taux d’intérêt élevés imposés pour contenir l’inflation.
Inégalité : des pyramides de richesse au milieu de déserts de pauvreté
L’inégalité économique peut être analysée sous plusieurs angles : l’inégalité des revenus (salaires et bénéfices) ; l’inégalité de la richesse personnelle (actifs moins dettes) ; l’inégalité des actifs en capital (propriété d’entreprises et actions) ; l’inégalité de la richesse et des revenus entre les nations ; et l’inégalité au sein même des nations. Il est important de souligner que l’inégalité est toujours relative, et non absolue. Les niveaux alarmants et considérables d’inégalité, sous tous ses aspects, révèlent également un dysfonctionnement profond du système.
Les pays du Sud ne rattrapent pas les nations impérialistes et riches du Nord, que ce soit en termes de revenu par habitant, de productivité ou de tout autre indice de développement humain. Au contraire, les énormes inégalités de revenus et de richesse, tant au sein des nations qu’entre elles, continuent de s’aggraver.
En 2023, le revenu national moyen par habitant dans le monde (y compris la valeur en nature des services publics) était d’environ 12 800 € par an (PPA), soit 1 065 € par mois. Cependant, cela masque d’immenses disparités : en Afrique subsaharienne, le revenu moyen n’était que de 240 € par mois, contre plus de 3 500 € en Amérique du Nord et en Océanie, soit un rapport de 1 à 15. Le produit annuel par habitant aux États-Unis a atteint 73 000 dollars, soit environ 26 fois plus que dans les pays à faible revenu. Même les économies à revenu intermédiaire inférieur comme l’Inde, le Nigeria et les Philippines ne produisent qu’environ un neuvième du produit par habitant des États-Unis.
La croissance rapide de certaines régions d’Asie, en particulier la Chine et l’Inde, a permis à de nombreuses personnes de sortir de l’extrême pauvreté. Toutefois, selon le Rapport mondial sur les inégalités, les 0,1 % et 1 % les plus riches du monde ont capté une part extrêmement disproportionnée des gains. En 2020, les 1 % les plus riches ont reçu 20,6 % des revenus mondiaux, soit une augmentation de 2,8 points de pourcentage depuis 1980. Les 0,1 % les plus riches, à eux seuls, ont empoché 8,59 % des revenus, soit une augmentation de près de deux points de pourcentage depuis 1980.
La Chine a rapidement développé sa propre élite fortunée, mais bien que sa population soit plus de quatre fois supérieure à celle des États-Unis, ce dernier pays compte encore 4,8 fois plus de personnes fortunées.
La pyramide de la richesse mondiale met en évidence les extrêmes :
seuls 60 millions d’adultes (1,6 % des adultes dans le monde) possèdent 226 000 milliards de dollars, soit 48,1 % de toute la richesse personnelle.
À l’autre extrémité, 1,57 milliard d›adultes (41 % des adultes dans le monde) possèdent ensemble seulement 2 700 milliards de dollars, soit 0,6 % de la richesse personnelle mondiale. Les 1 % les plus riches du monde possèdent toujours environ 42 % de toute la richesse personnelle, un chiffre inchangé depuis 1995.
Si l’on additionne les classes moyennes, 3,1 milliards d’adultes (82 % de la population mondiale) ne possèdent que 61 000 milliards de dollars, soit 12,7 % de la richesse totale. Les 87,3 % restants sont concentrés entre les mains de 680 millions de personnes, soit seulement 18,2 % de la population adulte mondiale.
Les disparités régionales restent marquées. En 2024, la richesse personnelle a augmenté en Europe de l’Est (à partir d’un niveau bas) et en Amérique du Nord, mais a diminué en Amérique latine, en Europe occidentale et en Océanie. La richesse moyenne des ménages en Grande-Bretagne a diminué de 3,6 %, soit la deuxième baisse la plus prononcée parmi les principales économies. La richesse personnelle moyenne par adulte en Amérique du Nord est six fois supérieure à celle de la Chine, douze fois supérieure à celle de l’Europe de l’Est et près de vingt fois supérieure à celle de l’Amérique latine.
Les inégalités mondiales en matière de richesse personnelle se sont aggravées depuis le début du XXIe siècle. Même après l’apartheid, l’Afrique du Sud reste le pays le plus inégalitaire en termes de répartition des richesses (mesurée par le coefficient de Gini), suivie de près par le Brésil. Le coefficient de Gini s’est aggravé dans de nombreuses régions pendant la « longue dépression » qui a débuté en 2008. Parmi les nations capitalistes avancées, la Suède se classe étonnamment au même niveau que les États-Unis en matière d’inégalités. Le capitalisme, qu’il soit néolibéral ou social-démocrate, produit la même concentration de richesse.
Cependant, les États-Unis se distinguent comme le pays le plus inégalitaire parmi les économies du G7. L’ampleur des inégalités américaines est stupéfiante. À titre d’illustration :
• 100 000 dollars en billets de 100 forment une pile de 10,9 cm.
• 1 million de dollars équivaut à 109,5 cm.
• 1 milliard de dollars représente une pile de 1 087 mètres (environ la hauteur de 12 terrains de football).
• La fortune d’Elon Musk, qui s’élève à 486 milliards de dollars, atteindrait 530 kilomètres de hauteur, soit 60 monts Everest réunis.
L’inégalité de la richesse est indissociable de l’inégalité des revenus. Plus la concentration de la richesse personnelle est élevée dans une société, plus l’inégalité des revenus a tendance à être importante. Le Rapport mondial sur les inégalités montre que, depuis 1980, la part du revenu national perçue par les 10 % les plus riches a augmenté dans presque tous les pays. Aujourd’hui, les 10 % les plus riches captent plus de 50 % du revenu mondial, tandis que les 50 % les plus pauvres ne reçoivent que 5 %.
L’Inde en est un exemple frappant : alors que sept millions de ses citoyens font partie de l’élite mondiale, 700 millions font partie des plus pauvres du monde. Les 1 % les plus riches de l’Inde accaparent actuellement 73 % du revenu national et possèdent plus de quatre fois la richesse des 70 % les plus pauvres (953 millions de personnes). Une employée de maison en Inde aurait besoin de 22 277 ans pour gagner ce qu’un cadre supérieur d’une entreprise technologique gagne en une seule année.
L’inégalité n’est pas seulement contemporaine, elle est profondément historique. Une étude réalisée à Florence par deux économistes de la Banque d’Italie a révélé que les familles les plus riches d’aujourd’hui sont les descendantes directes de celles qui l’étaient il y a 600 ans. Depuis le capitalisme marchand de la Renaissance italienne, en passant par le capitalisme industriel, et aujourd’hui sous le capitalisme financier mondial, la richesse est restée concentrée dans les mêmes lignées.
Ainsi se confirme la prédiction faite par Marx il y a 150 ans : le capitalisme conduit à une concentration et à une centralisation implacables de la richesse, en particulier dans les moyens de production et la finance. Contrairement aux promesses optimistes des économistes conventionnels, la pauvreté reste la norme mondiale pour des milliards de personnes, tandis que les inégalités continuent de s’aggraver dans les économies avancées, à mesure que le capital s’accumule entre les mains d’un nombre toujours plus restreint de personnes.
Une croissance sans grâce : l’érosion du niveau de vie
Dans sa dernière analyse de l’économie britannique, le FMI a exhorté le gouvernement à respecter strictement ses règles budgétaires en matière de déficit et de dette. Avec une prévision de croissance de seulement 1,4 % par an pour le reste de la décennie, il a recommandé d’augmenter les impôts, de freiner la hausse des retraites (qui sont déjà parmi les plus basses d’Europe), d’introduire des taxes pour le système national de santé (NHS) (démantelant ainsi le système de santé gratuit mis en place en 1948), ou une combinaison de ces mesures. Il a également soutenu la réduction des allocations aux personnes handicapées.
Le FMI a également averti que, à moins que le gouvernement ne renonce à son engagement de ne pas augmenter les impôts des travailleurs, des coupes plus importantes dans les services publics seraient nécessaires. Il a suggéré de lier l’accès aux services à la capacité de paiement des personnes — comme les tickets modérateurs pour les soins médicaux des personnes aux revenus les plus élevés —, en exemptant les plus pauvres.
On observe une tendance similaire au Japon, où la stagnation persistante depuis les années 1990 est due à une forte baisse de la rentabilité des investissements productifs, plus prononcée que dans tout autre pays du G7. Les gouvernements successifs du PDL ont considérablement réduit les prestations de sécurité sociale des personnes âgées de 30 % en termes réels depuis 1995, et les dépenses de santé par habitant pour les personnes âgées de plus de 65 ans ont diminué de près de 20 % en trois décennies. Dans le même temps, les taux d’imposition des entreprises ont été réduits de 50 % à 15 %. Si les bénéfices ont augmenté de 8 % à 16 % du PIB, les recettes fiscales ont chuté de 4 % à 2,5 %. Au lieu de stimuler l’investissement productif, les entreprises ont accumulé des capitaux ou les ont détournés vers les obligations d’État et les marchés boursiers.
Aux États-Unis, la croissance des salaires des citoyens ordinaires a connu un ralentissement constant depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une moyenne annuelle de seulement 0,9 % depuis 2008. Corrigés de l’inflation, les salaires horaires des travailleurs manuels stagnent aux niveaux de la fin des années 1970, malgré d’énormes gains de productivité.
Cet écart entre les chiffres de la croissance et le niveau de vie des individus trouve son origine dans la nature changeante de la croissance. Depuis le tournant néolibéral des années 1980, des secteurs improductifs tels que la finance, l’immobilier et les marchés boursiers se sont développés par rapport à l’économie réelle. Leurs cycles d’expansion sont interprétés à tort comme une prospérité, mais ils n’apportent que peu d’améliorations pour la majorité. En 2023, la finance, l’assurance, l’immobilier et les services de location représentaient plus de 20 % du PIB américain, tandis que l’industrie manufacturière tombait à 10 % et l’agriculture à moins de 1 %. La croissance alimentée par la spéculation et la prise de bénéfices à court terme est une « croissance sans joie », qui n’apporte que peu de soulagement aux travailleurs.
Ce modèle n’est pas propre aux États-Unis. D’autres économies néolibérales façonnées par le consensus de Washington, comme l’Inde, présentent la même contradiction : une forte croissance sur le papier accompagnée d’une détérioration des conditions sociales.
La Chine, les BRICS et le mythe du bloc anti-impérialiste
Au cours des dernières années, avec le déclin de l’impérialisme occidental et de son ordre (néo)libéral, ainsi que l’essor de la Chine, l’idée selon laquelle des alliances telles que les BRICS pourraient constituer une alternative au système de Bretton Woods et à l’ordre mondial fondé sur le consensus de Washington (OTAN, FMI, Banque mondiale, UE, etc.) s’est répandue.
Malgré quelques réformes symboliques de ses structures de vote et de prise de décision au cours des huit dernières décennies, le FMI reste fermement sous le contrôle du G7, laissant la plupart des autres pays pratiquement sans voix. Sur les 24 sièges du conseil d’administration du FMI, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, le Japon et la Chine occupent des sièges individuels, tandis que les États-Unis conservent un droit de veto sur toutes les décisions importantes.
Sur le plan économique, le FMI est connu pour mettre en œuvre des « programmes d’ajustement structurel ». Les prêts aux économies en difficulté ne sont accordés qu’à condition que les gouvernements réduisent leur déficit, diminuent les dépenses publiques, libéralisent le commerce et privatisent des secteurs clés. De même, les critères de la Banque mondiale pour l’octroi de prêts et d’aide aux nations les plus pauvres reposent sur l’idée néoclassique selon laquelle l’investissement public existe simplement pour « stimuler » l’investissement privé et le développement. Ainsi, ses économistes ignorent délibérément le rôle de la planification et de l’investissement dirigés par l’État.
Ces institutions représentent le cœur de la machine financière et économique de l’impérialisme occidental, créées après la Seconde Guerre mondiale pour poursuivre le pillage colonial sous de nouvelles formes. Il n’est pas nécessaire de détailler comment, au cours des sept ou huit dernières décennies, et en particulier au cours des trois dernières, les puissances occidentales ont déclenché des guerres et des agressions dans une région après l’autre, souvent par l’intermédiaire de l’OTAN, détruisant des nations et commettant des massacres à une échelle sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Cette barbarie économique et militaire n’a fait que s’intensifier à mesure que l’impérialisme occidental déclinait.
L’oppression et l’exploitation implacables de l’impérialisme occidental ont, comme on pouvait s’y attendre, alimenté une haine et une colère immenses dans le tiers monde. Cela a inévitablement conduit beaucoup de gens à rechercher des alternatives ou des alliés parmi les puissances de l’Est. Jusqu’en 1991, l’Union soviétique a principalement joué ce rôle. Cependant, au cours des deux dernières décennies, une tendance croissante dans les milieux de gauche a été de considérer la Chine — et, dans une certaine mesure, la Russie — comme une alternative « anti-impérialiste ».
Ce discours prend diverses formes. L’une d’elles est la conviction que la Chine représente une force plus progressiste que l’impérialisme occidental. Dans tout le Sud global, des individus, des organisations de gauche et même des factions étatiques promeuvent activement cette vision. De même, certains évoquent un « bloc de l’Est » émergent de puissances anti-impérialistes, qui comprendrait la Chine, la Russie, l’Iran et plusieurs nations du tiers-monde. Alors que certains affirment que ce bloc existe déjà, d’autres expriment simplement leur souhait qu’il existe.
D’un autre côté, certains ne considèrent pas la Chine comme progressiste, mais exagèrent sa force et son influence. Pour eux, la Chine, grâce à ses capacités économiques, technologiques et militaires, est déjà l’égale — voire plus puissante — des États-Unis, et l’impérialisme américain est pratiquement fini. À l´inverse, une autre position simpliste consiste à qualifier l›économie chinoise de simplement « capitaliste », en appliquant à la Chine la dynamique et les catégories des économies de marché — et même les analyses des économistes impérialistes occidentaux —, en ignorant ses caractéristiques uniques et particulières.
La vérité, cependant, est qu’au cours des trois dernières décennies, la Chine s’est imposée comme une puissance économique mondiale importante et dispose désormais d’une armée moderne et en pleine expansion. Dans le même temps, l’impérialisme occidental — en particulier les États-Unis — connaît une faiblesse, un déclin et une fragmentation historiques. Il s’agit toutefois d’un processus contradictoire et continu, dont l’issue finale reste incertaine.
Considérons donc l’ascension de la Chine. En quelques décennies seulement, elle est devenue la deuxième économie mondiale. En termes de population, cela représente la plus forte croissance économique de l’histoire de l’humanité : une nation de plus d’un milliard d’habitants qui a connu des décennies d’expansion ininterrompue sans récession majeure.
Au moment de la révolution de 1949, la Chine figurait par mi les pays les plus arriérés du monde, en proie à la pauvreté, à l’analphabétisme, à l’ignorance, à l’esclavage et à certains aspects de la barbarie. Aujourd’hui, c’est une société urbanisée, industrialisée, alphabétisée et relativement saine. En termes de niveau de vie, de culture et de développement, elle dépasse de loin des pays comme le Pakistan, l’Inde et le Bangladesh, alors que tous se trouvaient pratiquement au même niveau entre 1947 et 1949.
Depuis 1978, la consommation des ménages en Chine a augmenté de 1 800 %. Le taux d’alphabétisation est passé de seulement 20 % en 1949 à 98 % aujourd’hui. L’espérance de vie est désormais plus élevée qu’aux États-Unis. Selon les normes de la Banque mondiale, la Chine est sur le point d’atteindre le statut de pays à « revenu élevé ».
La participation de la Chine au PIB mondial atteignait à peine 2 % en 1982 ; en 2012, elle avait atteint près de 15 %. En 2010, elle a dépassé le Japon et est devenue la deuxième économie mondiale, et les prévisions suggèrent qu’elle dépassera les États-Unis d’ici 2028. Cependant, selon la parité de pouvoir d’achat (PPA), elle est déjà devenue la première économie mondiale, dépassant les États-Unis vers 2014.
Entre 2002 et 2022, la part de la Chine dans le PIB mondial est passée de 8 % à 18 %, tandis que celle des États-Unis a diminué de près de 20 % à 15 %. En 2024, la part de la Chine avait atteint environ 20 %. La panique qui s’empare des impérialistes occidentaux n’est donc pas infondée : les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Considérons ce qui suit : rien qu’entre 2011 et 2013, la Chine a utilisé 6,6 gigatonnes de béton, soit deux gigatonnes de plus que ce que les États-Unis ont consommé pendant tout le XXe siècle. Aujourd’hui, la Chine progresse rapidement dans des secteurs de pointe tels que l’intelligence artificielle, les trains à grande vitesse, l’exploration spatiale et la robotique, dépassant souvent les États-Unis. Le véritable objectif des restrictions commerciales américaines n’est pas simplement de réduire leur déficit commercial, mais d’empêcher la Chine de s’imposer dans ces domaines technologiques, longtemps considérés comme l’apanage de l’impérialisme américain et occidental.
De la fin des années 1970 à 2018, l’économie chinoise a connu une croissance annuelle moyenne de 9,5 %, contre seulement 2,8 % pour l’économie mondiale. En d’autres termes, pendant quarante ans, la Chine a doublé la taille de son économie environ tous les huit ans.
Après la mort de Mao, les réformes de marché de Deng Xiaoping à partir de 1978 ont fourni une bouée de sauvetage importante au capitalisme occidental, lui permettant d’accéder à de vastes réserves de main-d’œuvre bon marché. Mais cette main-d’œuvre n’était pas seulement bon marché, elle était également qualifiée, disciplinée, en bonne santé et éduquée. Cette distinction est cruciale.
Les impérialistes occidentaux ont supposé que la restauration capitaliste finirait par transformer la Chine en un État libéral et néolibéral et l’intégrerait comme un partenaire subordonné et obéissant, comme ils l’espéraient pour la Russie après l’effondrement soviétique. Cependant, dans les deux cas, ces attentes se sont transformées en cauchemars.
Pourquoi ? La réponse se trouve dans l’histoire. La Russie et la Chine ont toutes deux suivi des trajectoires qui les ont différenciées des régions colonisées et en retard du Sud. La révolution bolchevique de 1917 a aboli le féodalisme et le capitalisme en Russie, créant une économie planifiée, bien que sous une forme bureaucratique et stalinienne. De même, après 1949, la Chine a largement adopté le modèle soviétique. Cette histoire les a nettement distingués de l’Asie du Sud, de l’Afrique et de l’Amérique latine, où le capitalisme et le colonialisme ont laissé des traces plus profondes.
Si la main-d’œuvre bon marché et les marchés peu coûteux expliquaient à eux seuls le succès de la Chine après 1978, pour quoi d’autres pays du tiers monde, à l’exception de quelques cas mineurs, n’ont-ils pas obtenu des résultats similaires ? Lequel de ces deux facteurs, par exemple, fait défaut au Pakistan ? Les théoriciens du capital n’ont pas de réponse réelle à ces questions.
Le fait est que, malgré les inefficacités et la mauvaise gestion bureaucratique, la propriété d’État et l’économie planifiée mises en place après 1949 ont accompli des tâches que le capitalisme n’a pas réussi à réaliser dans des pays comme le Pakistan : réformes agraires, modernisation de l’agriculture, industrialisation à grande échelle et progrès technologiques. Les bases de la croissance postérieure à 1978 ont été jetées sous le gouvernement de Mao, notamment par la création d’une main-d’œuvre qualifiée, alphabétisée et en bonne santé, ainsi que par la construction d’une infrastructure économique et sociale considérable.
Les premiers plans quinquennaux postérieurs à 1953 ont été décisifs. Des milliers d’usines et d’installations ont été construites, permettant à la Chine d’atteindre l’autosuffisance dans la production d’acier, d’électricité, de véhicules, de machines et même d’avions. Dans les années 1980, la Chine restait pauvre en termes de revenus et de consommation, tout comme l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh ; cependant, ses indicateurs sociaux (alphabétisation, espérance de vie et mortalité infantile) étaient déjà bien supérieurs, même par rapport aux pays d’Asie du Sud en 2025.
Si l’on fait abstraction des deux dernières décennies, le développement antérieur de l’Union soviétique a largement dépassé celui de la Chine. Mais grâce à ces fondements, les deux pays ont réussi à conserver un certain degré d’indépendance vis-à-vis de l’impérialisme occidental, malgré les dommages causés par la restauration capitaliste.
Cela dit, leurs chemins ont divergé de manière significative après les années 1980. En Russie, l’effondrement de l’URSS a détruit l’État stalinien. Sous l’effet de la « thérapie de choc », les actifs de l’État ont été vendus dans une frénésie de pillage, donnant naissance à une bourgeoisie corrompue et mafieuse composée d’anciens bureaucrates et d’opportunistes. Il en a résulté un capitalisme parasitaire et autoritaire aux ambitions impérialistes qui rappelaient l’ancien régime tsariste. Symboliquement, la Russie de Poutine a rétabli l’aigle bicéphale tsariste couronné et croisé comme emblème national. La richesse nationale est considérée comme une propriété privée, tandis que Poutine lui-même a amassé une fortune estimée à plus de 200 milliards de dollars.
Au fond, la Russie ne s’est jamais complètement remise du traumatisme socioculturel de l’effondrement soviétique ni des ravages de la thérapie de choc. Si Poutine a supervisé une certaine reprise au cours de ses premières années, l’économie est depuis longtemps stagnante et dépendante des revenus du pétrole et du gaz. Ces économies basées sur les ressources primaires peuvent accumuler des richesses, mais elles restent structurellement faibles, illustrant ce que l’on appelle le « syndrome hollandais ».
Le cheminement de la Chine vers la restauration capitaliste a été très différent. Fondamentalement, l’État stalinien a survécu et a maintenu un contrôle étroit sur l’économie. La dernière vague importante de privatisations a eu lieu à la fin des années 1990, lorsque de petites industries non rentables ont été vendues ou fermées. Les principaux secteurs de l’économie — la banque, la finance et l’industrie lourde — sont restés entre les mains de l’État. Ces secteurs ont été modernisés et intégrés dans le développement national. À ce jour, la Chine est la seule grande économie qui applique encore des plans quinquennaux. La propriété et la planification étatiques ont joué un rôle central dans sa croissance, ce que les économistes conventionnels reconnaissent rarement.
Cependant, ce n’est qu’une partie de l’histoire. Depuis les années 1990, le secteur privé en Chine s’est rapidement développé et domine désormais plus de la moitié de l’économie. Une nouvelle bourgeoisie a émergé, avec plus de 800 multimillionnaires et d’innombrables millionnaires. Parallèlement, la corruption, les inégalités, la criminalité, la lutte acharnée pour la survie et l’exploitation se sont multipliées. Le Parti communiste est passé d’une force idéologique et politique à une vaste machine administrative qui supervise et contient la bête du « capitalisme d’État ».
Certes, les principaux facteurs de l’économie chinoise restent largement sous le contrôle de l’État, mais ce système contradictoire est loin d’être stable. Les récentes turbulences sur le marché boursier et dans le secteur immobilier, les appels de Xi Jinping à la « prospérité commune », les réorganisations bureaucratiques, les mesures répressives contre la corruption – qui touchent parfois même de grands capitalistes et des fonctionnaires qui défient les directives du parti-État –, ainsi qu’une censure et une répression strictes, indiquent de profondes contradictions qui pourraient devenir plus visibles à l’avenir.
Malgré ses réalisations, la Chine reste encore loin derrière les économies impérialistes occidentales en termes de PIB par habitant. L’écart est considérable : alors que le PIB par habitant des États-Unis est d’environ 80 000 dollars, celui de la Chine n’est que d’environ 13 000 dollars (et même en termes de parité de pouvoir d’achat, il est inférieur à un tiers de celui des États-Unis). Pour surmonter cette situation, la bureaucratie chinoise étend de manière agressive son influence mondiale et son accès aux ressources ; cependant, certains chercheurs affirment que les ressources nécessaires pour que la Chine « rattrape » les États-Unis n’existent tout simplement pas sur cette planète.
En comparaison, la soi-disant « Inde brillante » de Modi n’est qu’une parodie grotesque. Ses statistiques de croissance sont exagérément gonflées, tandis que les avantages pour les masses laborieuses sont insignifiants. Il s’agit d’une forme de croissance encore plus faussée que celle qu’a connu le Pakistan sous le régime de Musharraf. Les inégalités ont atteint des niveaux pires que sous la domination coloniale britannique. Comme mentionné précédemment, d’un côté, sept millions d’Indiens issus de la classe moyenne supérieure et aisée figurent parmi les plus riches du monde. De l’autre, 700 millions de personnes vivent dans des conditions pires que celles des Africains les plus pauvres. Selon une étude réalisée par la société indienne de capital-risque Blume, un milliard d’Indiens ne peuvent même pas envisager autre chose que les besoins fondamentaux de survie.
La participation des 10 % les plus riches au revenu national indien est passée de 34 % en 1990 à plus de 57 % aujourd’hui, tandis que celle des 50 % les plus pauvres a chuté de 22,5 % à seulement 15 %. Une telle société peut-elle rester stable sans alimenter constamment l’hystérie religieuse, la superstition et la haine sectaire ?
En ce qui concerne les BRICS : le groupe initial comprenait le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, mais il s’est désormais élargi à l’Égypte, l’Éthiopie, les Émirats arabes unis, l›Indonésie, etc. Cependant, contrairement aux alliances occidentales, les BRICS sont loin d’être cohésifs. La Chine représente près de 20 % de l’économie mondiale, l’Inde environ 7 %, tandis que la Russie, le Brésil et l’Afrique du Sud ne contribuent respectivement qu’à hauteur de 3 %, 2,4 % et 0,6 %. Le poids économique, l’influence et les niveaux de développement diffèrent donc considérablement.
De plus, la plupart des membres n’entretiennent pas de relations cordiales. L’Inde est en conflit depuis longtemps avec la Chine ; des contradictions persistent entre la Russie et le Brésil ; l’Iran est en conflit avec les pays arabes, etc.
Pendant ce temps, l’impérialisme occidental continue de dominer non seulement financièrement, mais aussi militairement. Le dollar américain reste l’épine dorsale de la finance mondiale : il participe à 90 % de tous les échanges de devises, à 50 % du commerce mondial et représente 60 % des réserves de devises. Le yuan chinois, malgré ses progrès récents, ne représente que 7 % des transactions mondiales et 3 % des réserves.
Derrière cette domination du dollar se cache une puissance militaire écrasante. Les États-Unis disposent de 750 bases militaires dans 80 pays, tandis que la Chine n’en compte que quatre, dont seule celle de Djibouti est stratégiquement importante, même si Pékin prévoit de s’étendre. L’armement américain reste le plus avancé, et Washington dépense au moins trois fois plus que la Chine en matière de défense. Malgré une modernisation rapide, l’armée chinoise est à la traîne tant en termes de qualité que d’ampleur, tandis que la Russie est encore plus faible. C’est pourquoi ces deux États évitent dans une large mesure toute expansion militaire mondiale, se concentrant plutôt sur leurs propres frontières et régions.
La Russie dispose de 21 bases étrangères importantes, principalement en Asie centrale et en Europe de l’Est, ainsi qu’en Syrie, et s’est récemment étendue à l’Afrique, avec des rapports faisant état de bases au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ces pays étaient jusqu’à récemment sous une domination française intense, mais des coups d’État motivés par la colère anti-impérialiste ont chassé les troupes françaises. Cependant, ces nouveaux régimes n’ont pas de programmes révolutionnaires pour rompre avec le capitalisme ; au contraire, à l’instar de Maduro au Venezuela, ils se tournent vers la Chine et la Russie comme « alternatives » à l’Occident. Moscou a également déployé son tristement célèbre groupe Wagner dans toute la région.
C’est un exemple clair de « l’ennemi de mon ennemi est mon ami ». Pourtant, certains secteurs de gauche présentent à tort ces alliances comme la preuve des « références anti-impérialistes » de la Chine et de la Russie. En réalité, ce n’est guère plus qu’une illusion.
Historiquement, les bureaucraties staliniennes de l’URSS et de la Chine ont impitoyablement instrumentalisé les luttes anti-impérialistes pour faire avancer leurs propres agendas de politique étrangère. La réalité actuelle peut être encore plus cynique : si la Chine et la Russie peuvent offrir des prêts ou une aide à bas prix pour étendre leur influence, cela ne signifie pas pour autant qu’elles sont exemptes d’ambitions impérialistes. Rien n’est gratuit !
Il en va de même pour la Banque de développement des BRICS, qui, comparée au FMI ou à la Banque mondiale, est insignifiante. Les États capitalistes qui représentent chaque centime de « l’aide au développement » ne sont pas des institutions philanthropiques. Pour ces raisons, compte tenu de leurs contradictions internes et de la crise plus large du capitalisme mondial, les alliances telles que les BRICS ne sont pas en mesure de construire un nouvel ordre financier comparable à celui de Bretton Woods, du moins pas dans un avenir prévisible. Le déclin des anciennes puissances impérialistes et l’essor de nouvelles puissances sont semés de contradictions et, comme l’histoire le montre, ces transitions peuvent être explosives.
La théorie de l’impérialisme repose sur la théorie marxiste des crises et du marché mondial. Les monopoles peuvent partiellement échapper à l’égalisation des taux de profit en imposant des prix supérieurs aux coûts de production, garantissant ainsi des profits monopolistiques et évitant temporairement la baisse du taux de profit. Cependant, les monopoles restent instables : ils peuvent être démantelés par des concurrents plus productifs, et sur le marché mondial, la concurrence féroce entre les capitaux dominants génère son propre « taux de profit monopolistique ». Ainsi, la loi de la valeur est modifiée au niveau international, car la tendance vers un taux de profit global moyen est bloquée par le capital monopolistique concentré.
Il en résulte un développement inégal et combiné dans les (semi-)colonies. Certains secteurs reçoivent des apports de capitaux et se développent selon les normes internationales, tandis que d’autres stagnent parce que les biens nécessaires doivent être importés aux prix du marché mondial. Les déficits commerciaux et la dette obligent ces États à dévaluer leurs monnaies et, pour éviter l’inflation, à augmenter les taux d’intérêt, ce qui sape l’industrie locale et impose des mesures d’austérité. Les investissements étrangers s’intègrent de plus en plus (dans les semi-colonies) dans les chaînes de production mondiales, où la majeure partie de la valeur est captée par les monopoles des centres impérialistes.
Les taux de profit diffèrent encore considérablement entre les pays impérialistes et les semi-colonies. Même dans les semi-colonies les plus avancées ou exportatrices de matières premières, l’échange inégal opère par le biais de l’exportation de capitaux, ce qui entraîne un développement faussé et inégal. Selon Lénine, l’exportation de capitaux reste le mécanisme clé par lequel les centres impérialistes obtiennent des superprofits.
Lénine ajoute également une dimension politique : la division monopolistique de l’économie mondiale soutient un système de grandes puissances qui divisent politiquement la planète. La domination économique ne détermine pas mécaniquement cette structure ; les changements dans le poids économique des monopoles et des États entrent régulièrement en conflit avec les hégémonies existantes. Ces contradictions génèrent des conflits et, potentiellement, des guerres, ce qui conduit à de nouvelles divisions du monde, si le capitalisme survit à la crise mondiale qui en résulte.
Un bon capitalisme ou le socialisme ?
La nature intrinsèquement instable et crise du capitalisme est indéniable. Depuis la crise de 2008, même les défenseurs les plus fervents du système ne peuvent l’ignorer. Cependant, confinés dans les limites de l’idéologie capitaliste, ils ne peuvent ou ne veulent pas voir au-delà de ses limites. Beaucoup justifient et protègent consciemment cet ordre défectueux et exploiteur simplement parce que leur subsistance en dépend.
Comme Marx l’a écrit à plusieurs reprises, la crise capitaliste est une expression nécessaire de la loi fondamentale du développement capitaliste : le développement du capital se heurte constamment à des limites (TDTG, suraccumulation) inhérentes au capital lui-même, qui ne peuvent être surmontées que par la destruction massive de capital afin de créer une expansion du capital à un niveau nouveau et étendu. Cela signifie qu’à chaque cycle, entre les périodes de crise, le capital développe les forces productives à un niveau supérieur, l’accumulation de capital progresse avec une quantité et une qualité nouvelles, le capital se concentre davantage, etc. Cela signifie également que chaque fois que cette crise systémique s’aggrave, elle devient plus préjudiciable à l’ensemble de la société. En ce sens, il n’y a pas d’effondrement automatique, seulement un besoin croissant de sortir de cette « économie de la ruine ».
Le réformisme, qu’il soit déguisé en socialisme, en anti-impérialisme ou en communisme, souffre des mêmes limites. Son incapacité à rompre avec les relations de production existantes se manifeste dans des variantes de gauche et de droite, chacune offrant des excuses pour les effondrements répétés du système. Les réformistes affirment souvent que le capitalisme en soi n’est pas le problème, mais qu’il est mal géré ; qu’avec quelques corrections ou mesures d’équilibre, il peut fonctionner de manière « équitable ».
Nous avons déjà vu comment le néolibéralisme n’était rien d’autre qu’un vaste projet impérialiste visant à faire face à la crise historique du capitalisme, avec des conséquences catastrophiques pour la majorité de l’humanité. Cependant, beaucoup, en particulier les courants réformistes de gauche et certains secteurs de l’aristocratie syndicale, rêvent encore d’un retour au « bon capitalisme » de l’après-guerre. Leurs recettes pour un capitalisme « humain » comprennent généralement la restructuration de la dette, des mesures antitrust et anticorruption, des impôts progressifs, des syndicats plus forts ou d’autres variantes du « capitalisme régulé ».
Mais cette perspective repose sur une erreur : celle de croire que l’âge d’or de l’après-guerre a été créé par des gouvernements éclairés, animés de « bonnes intentions » et menant des politiques « favorables aux citoyens ». En réalité, l’essor de l’après-guerre n’était pas le résultat d’une gestion bienveillante, mais de taux de profit historiquement élevés. Ces profits ont permis des réformes et des accords de classe temporaires. De plus, la bourgeoisie des pays capitalistes avancés a fait des concessions en grande partie par crainte : crainte de la révolution chez elle et du stalinisme à l’étranger.
Une fois ces conditions objectives disparues, le consensus s’est rapidement effondré. Les réformistes ne peuvent expliquer pourquoi cet « âge d’or » s›est effondré en seulement une ou deux décennies, car ils ne comprennent pas les contradictions internes du capitalisme. Ce qu›ils dénoncent comme causes de la crise – monopolisation, dette, déréglementation, privatisation, répression syndicale, exonérations fiscales pour les riches, etc. – ne sont ni des accidents ni des décisions malveillantes, mais les résultats inévitables d’un système étranglé par la crise de rentabilité. En définitive, tout réformisme actuel est contraint d’examiner attentivement les politiques visant à restaurer, ou du moins à amortir, les profits capitalistes. La politique du réformisme de gauche est donc dépourvue de toute base économique réelle, ce qui se reflète dans les échecs répétés des régimes réformistes traditionnels et populistes, les uns après les autres, à travers le monde.
Marx, même dans sa jeunesse, avait clairement compris que les contradictions du capitalisme ne peuvent être résolues au sein même du capitalisme. Si l’humanité reste prisonnière d’un système fondé sur la propriété privée et le profit, elle sombrera inévitablement dans la barbarie ou, pire encore, disparaîtra complètement. La production de marchandises doit être remplacée par la production pour satisfaire les besoins, fondée sur la propriété publique des moyens de production et la planification économique démocratique. Seul le socialisme peut mettre fin à l’absurde contradiction entre « pauvreté dans l’abondance » et « abondance dans la pauvreté ».
Depuis 1820, le PIB mondial est passé d’environ 1 630 milliards de dollars à plus de 166 000 milliards en 2023, soit une augmentation de plus de 10 000 %, ou environ cent fois. Cette croissance stupéfiante reflète l’immense développement des forces productives sous le capitalisme. L’humanité possède aujourd’hui des niveaux de richesse et des capacités technologiques inimaginables pour les générations précédentes.
Cependant, malgré cette avancée historique, des milliards de personnes restent prisonnières de la misère et de la pauvreté. Même dans la société capitaliste avancée, la lutte quotidienne pour la survie devient chaque jour plus difficile, et les contradictions entre les personnes s’aggravent de plus en plus. Les travailleurs d’aujourd’hui sont plus vulnérables et opprimés par le capital qu’à aucun autre moment de l’histoire.
Cependant, l’humanité possède déjà les forces productives qui, si elles étaient organisées rationnellement, pourraient transformer le monde en quelques décennies. Grâce à une planification mondiale sous le contrôle démocratique des travailleurs, nous pourrions multiplier la croissance économique, éliminer le chômage, la pauvreté, l’analphabétisme, le manque de logement et les maladies évitables en quelques années, tout en réduisant la journée de travail et en protégeant l’environnement. Un socialisme mature à l’échelle mondiale mettrait fin à la lutte quotidienne pour la survie, créant une société d’abondance, de prospérité et d’harmonie. Libérée des chaînes du profit, l’humanité pourrait consacrer son énergie à l’exploration et à la maîtrise de la nature et, à terme, de l’univers lui-même.
Approuvé par le IIIe Congrès mondial de la LIS




